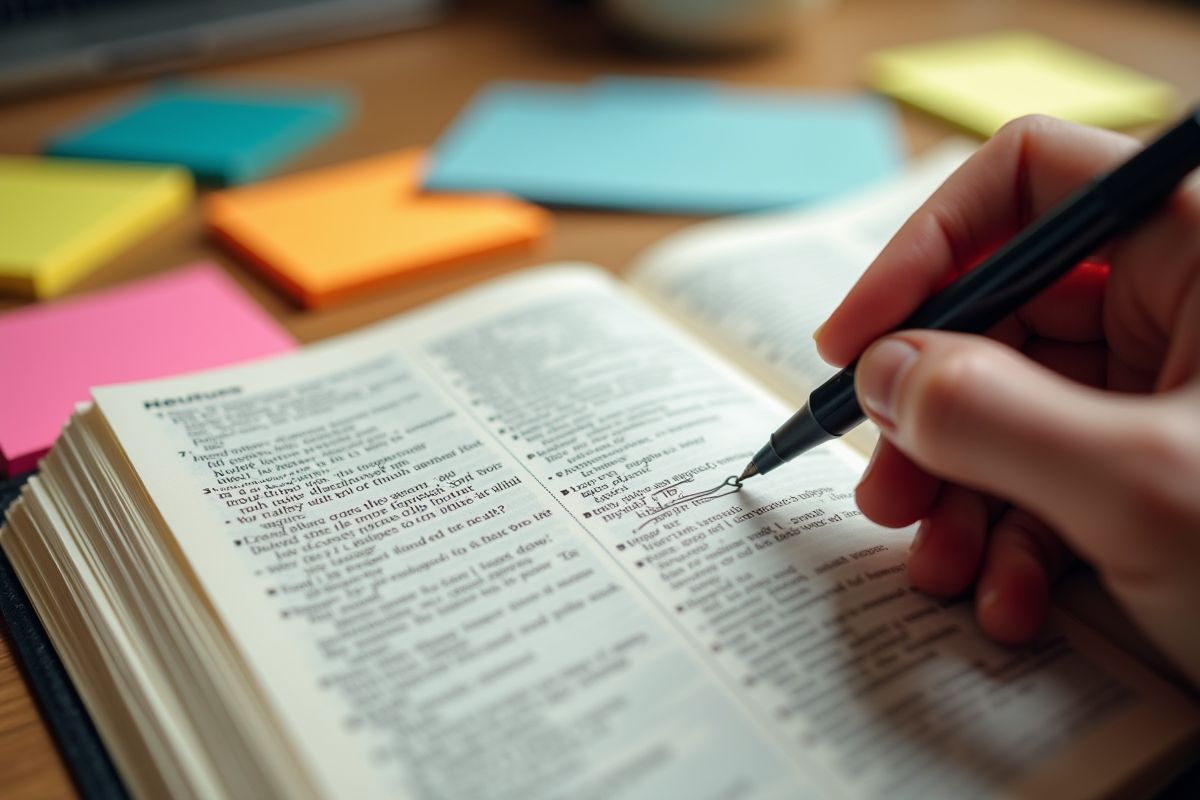L’adjectif « joli » connaît une fréquence d’emploi nettement supérieure au féminin dans la langue française contemporaine. Cette préférence grammaticale influence la perception des qualités attribuées selon le genre. Plusieurs guides de rédaction recommandent désormais l’usage de termes neutres afin d’éviter la reproduction de stéréotypes implicites.Les institutions publiques et certains médias appliquent depuis quelques années des recommandations strictes pour limiter la subjectivité et l’asymétrie des qualificatifs. Cette évolution linguistique vise à garantir une représentation égalitaire dans les échanges professionnels, éducatifs ou médiatiques.
Le langage et les stéréotypes : pourquoi la neutralité compte dans nos échanges
Dire « joli » n’est jamais un acte innocent. En français, la répartition de cet adjectif en dit long sur nos réflexes sociaux les plus ancrés. Utilisé massivement au féminin, il fabrique insidieusement des cadres pour les compliments, cantonnant les femmes à l’apparence et validant, souvent à leur insu, des visions du monde qu’on proclame égalitaires.
Choisir un terme, c’est poser un acte de représentation. Prenez la plume ou le clavier : une fois sur deux, employer « joli » pour décrire une collègue, une élève ou une réalisation féminisée, c’est reproduire un divorce lexical qui sépare l’éloge esthétique du mérite attribué aux hommes. Les institutions françaises l’ont compris, et nombre de médias à Paris suivent désormais des chartes de rédaction réfléchies à la loupe.
Opter pour la neutralité linguistique n’est pas un geste de façade. C’est ouvrir la langue à toutes celles et ceux que le masculin générique écarte, c’est permettre à chacun de se reconnaître dans des termes qui valorisent, sans réduire. La linguiste Éliane Viennot rappelle que cette attention déjoue la hiérarchie cachée derrière les adresses du quotidien. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes va dans le même sens, tout comme de nombreuses institutions soucieuses d’un partage du langage plus sain.
Utiliser des adjectifs neutres, c’est donner à chacun sa place, sans caricature ni assignation. C’est transformer la manière dont on pense la réussite, la créativité, l’engagement, que l’on s’adresse à une femme, un homme ou une personne non binaire. Changer de mot, parfois, c’est changer de regard.
Voici quelques pistes concrètes pour bannir les automatismes et renforcer l’équilibre dans vos compliments et appréciations :
- Langage non genré : remplacez « joli » par « harmonieux », « plaisant », « soigné », autant d’adjectifs qui n’enferment pas dans une case.
- Même exigence pour toutes et tous : évitez de réserver la valorisation esthétique au féminin, et cherchez des formules applicables à tous les genres.
- Diversifier son vocabulaire : s’appuyer sur les dictionnaires d’adjectifs épicènes ou neutres favorise une expression égalitaire au fil des écrits.
Comment ‘joli’ véhicule-t-il des biais de genre ?
Un mot paraît anodin, il façonne pourtant nos représentations : « joli », en particulier, révèle à quel point le genre imprègne la grammaire de nos louanges. Les travaux de Julie Abbou et Maria Candea sont sans équivoque. « Joli » cible d’abord le féminin, tandis que garçons ou hommes héritent de « beau », « élégant », « impressionnant ». Même les appréciations scolaires s’y prêtent : « joli travail » surgit sur les copies des filles, là où les garçons récoltent des « beaux résultats » ou « travaux solides », comme dans une mise en scène implicite de la réussite.
Ce réflexe linguistique recoupe mille autres détails, de la salle de classe au monde du travail. Le linguiste Pascal Gygax l’a documenté : à compétence égale, la nature du compliment ne pèse pas de la même façon selon qu’il s’adresse à une fille ou un garçon. Souvent, le féminin s’arrête au seuil de l’apparence, alors que le masculin recueille accolades et valorisations sur l’effort.
Pour sortir de ce pli, il existe un arsenal d’alternatives simples et puissantes. Miser sur les adjectifs épicènes, par exemple : « soigné », « harmonieux », « remarquable », « abouti ». Isabelle Meurville insiste sur cet enjeu : chaque mot compte pour desserrer l’étau des rôles préfabriqués et saluer les initiatives ou créations sans ambiguïté sur leur destinataire.
Des alternatives neutres et égalitaires à ‘joli’ : repenser ses compliments au quotidien
Changer de vocabulaire n’a rien d’anecdotique. Remplacer « joli » par des adjectifs non marqués, c’est adresser des compliments qui portent sur la qualité réelle, l’originalité ou la finition, sans assigner à une place ni rappeler d’anciennes habitudes. Cette démarche s’inspire des recommandations issues de dictionnaires consacrés aux adjectifs épicènes, portés par des collectifs engagés pour une communication sans stéréotypes.
On peut par exemple préférer à « joli groupe » les expressions « groupe harmonieux », « ensemble cohérent », « solution élégante », « composition réussie » ou « réalisation aboutie ». Ces formulations ouvrent l’horizon du compliment, visant l’action ou le rendu plutôt qu’un simple effet esthétique attaché à un genre.
Dans les écoles et les milieux associatifs, adopter un vocabulaire inclusif devient peu à peu la norme. À la place des admirations genrées, on lit de plus en plus « pertinent », « inspirant », « réussi », « lumineux » et tant d’autres adjectifs recommandés dans les guides de pratiques langagières.
Pour chaque occasion, prenez le temps d’identifier la qualité exact à mettre en avant : le soin, la créativité, la cohérence, l’originalité, l’efficacité ? Ajuster la formulation, c’est rendre service à la diversité des talents et promouvoir une égalité réelle dans la reconnaissance.
Guides pratiques et ressources pour approfondir la communication inclusive
Pour qui souhaite aller plus loin, des outils accessibles et méthodiques existent, conçus par des organismes publics, des associations ou des spécialistes de la langue inclusive. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes propose un référentiel détaillé : féminisation des noms de métiers, usage raisonné du point médian, et recommandations pour éviter le piège des adjectifs genrés tout en conservant une langue claire pour les personnes dyslexiques ou malvoyantes.
Des revues comme La Missive inclusive ou encore les ouvrages signés Claire Michelon et Éliane Viennot offrent des éclairages variés sur la mutation de la langue française. Face aux positions traditionnelles de l’Académie française, l’Office québécois de la langue française ou l’INRS en France multiplient les notes pratiques pour faire bouger les usages et mieux représenter la diversité du réel.
Voici une courte sélection d’apports recommandés par les experts pour diversifier et équilibrer son expression écrite ou orale :
- Les guides du Haut Conseil à l’égalité et les bases lexicographiques spécialisées, pour trouver rapidement des adjectifs épicènes ou neutres.
- Des ressources pédagogiques claires, utilisées par les enseignants, les collectifs citoyens et les médias exigeants.
Les recherches de Bernard Cerquiglini, Marie Loison ou Gwenaëlle Perrier servent de boussole pour qui souhaite réconcilier exigence grammaticale et ouverture aux pluralités. Introduire une double flexion, neutraliser certains qualificatifs, composer des phrases où chaque identité se retrouve : voilà des façons concrètes d’élargir le terrain d’expression de chacun. La langue française, parfois en retard, reste capable d’ouvrir grand ses portes à toutes les voix, pour peu qu’on fasse bouger les lignes, mot après mot.